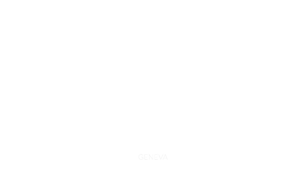Notes de lectures
INTRODUCTION
Aux sources d’une quête
Depuis notre plus jeune âge j’ai aimé les livres. Suprême honneur, on me permettait de feuilleter des ouvrages précieux découverts dans les bibliothèques de certains membres de ma famille dont les murs étaient ornés de miniatures persanes et de gravures anciennes, assuré que je ne pouvais qu’en prendre le plus grand soin. Feuilleter ces trésors et me plonger dans les illustrations qui les enluminaient étaient pour moi de grands moments de bonheur. J’admirais sans retenue ces témoins du savoir qui paraissaient résumer tout mon rapport à un monde encore plein de mystères, même si, vu mon jeune âge, je ne me plongeais pas dans une compréhension en profondeur de ces ouvrages et restait le plus souvent sur un niveau contemplatif, me limitant à en admirer les illustrations.

Mes parents avaient décidé de me sortir de ma position de fils unique et de ma tendance à l’enfermement dans mes rêveries. Chez les scouts de Carouge que j’avais brièvement fréquenté, on m’avait affublé alors du « totem » de patte de velours. Ce sobriquet affectueux résumait bien le rapport que j’avais aux choses et à l’autre. Ce livre exprime à sa façon, je l’espère, toute l’admiration et le respect que j’éprouve pour les auteurs qui ont contribué à la construction de mon savoir.
J’ai été initié au monde pendant la guerre lorsque mon père peintre et ma mère sculpteure et professeure de dessin, tous deux grands amateurs de montagne, m’ont entraîné par monts et par vaux entre 1941 et 1946 et chaque été dans les vallées et les alpages du Tessin, une expérience fondatrice qui a déterminé le cours de ma carrière. J’ai découvert alors avec fascination une nature encore sauvage, les montagnes abruptes, le sable cristallin des bords des lacs de montagne, le monde minéral de la géologie, une végétation luxuriante, des torrents impétueux, la société paysanne qui fascinait mon père et était encore préservée à l’abri du tourisme, sans oublier les merveilles de l’architecture religieuse baroque issue de la Contre-Réforme. J’ai retenu de cette période bénie, alors que l’Europe état à feu et à sang, la nécessaire unité des univers naturels et culturels.

Dans les alpages du Tessin avec mon père. Photo Eveline Gallay 279

Malcantone (Tessin) 1946. Photo Robert Gallay 388.
Mes parents s’absentaient souvent le week-end pourdes courses en haute montagne. Ils me laissaient alors chez mon grand-père et mes tantes à la villa des Tourelles dans le quartier Acacias. Je feuilletais à cette occasion avant de m’endormir les pages du dictionnaire Larousse en sept volumes découverts dans le bureau de ma marraine bibliothécaire. Ces ouvrages ont grandement contribué, tome après tome, à m’ouvrir l’esprit. Je possède encore aujourd’hui dans ma bibliothèque ces volumes jaunis d’un autre âge dont j’ai hérité comme un témoignage de mes curiosités d’enfant, vestiges aujourd’hui relayés par les ressources incomparablement plus efficaces de l’ordinateur.
Aux Beaux Arts mes parents avaient suivi des cours de géométrie descriptive et me parlaient avec enthousiasme de cet enseignement. Mon père utilisait ce savoir dans les dessins de meubles qu’il réalisait pour la maison pour laquelle il travaillait comme dessinateur avant d’être mobilisé et de perdre son travail. Je ne sais par quels canaux ce type d’analyse de la réalité m’a influencé et a développé dans ma réflexion cet esprit de géométrie dont on trouvera de nombreux témoignages dans ces pages lectures.
L’encyclopédie Wikipédia donne la définition suivante de cette discipline :
La géométrie descriptive fut inventée par le mathématicien français Gaspard Monge. C’est une branche de la géométrie qui définit les méthodes nécessaires à la résolution graphique des problèmes d’intersections et d’ombres entre volumes et surfaces définis de façon géométrique dans l’espace à trois dimensions. Il s’agit, en général, de rechercher la vraie grandeur de cotes, de tracer les courbes d’intersections de solides, de déterminer la nature de courbes (ellipse, parabole, hyperbole), de développer des surfaces (conique, cylindrique, prismatique…) ou encore de dessiner un objet selon un angle de vision donné (rotation, rabattement, changement de plan dans l’espace).
Cette discipline est aujourd’hui à la base des modélisations 3D, dans laquelle ma fille Béatrice, formée en Californie, excelle. Je n’en fais ici qu’un usage métaphorique très lâche.
Je retrouverai bien plus tard au début des années 60 cet esprit de géométrie lorsque j’assisterai au Collège de France aux cours de Lévi Strauss sur les mythes amérindiens et aux séminaires donnés dans le cadre de cet enseignement par Lucien Sebag (1971)sur les mythes du Sud-Ouest américain. Au tableau noir les schémas rendant compte des transformations structurales des mythes et des concepts qui en formaient l’ossature me fascinaient en tant que support indispensable de la réflexion et se trouvait en phase avec l’univers visuel qui avait baigné mon enfance. Cette manière de concevoir la compréhension de la pensée se retrouvera, sous une forme encore plus systématique, dans les enseignements de Jean-Claude Gardin que j’ai suivis (Gardin, Gallay à paraître).
Anatomie d’une présentation
Les présentes pages sont le témoignage des lectures que j’ai retenues comme essentielles pour le développement de mes réflexions alors que, bien plus tard, après des études de sciences naturelles à Genève puis de préhistoire et d’ethnologie à Paris, j’avais décidé de devenir archéologue et anthropologue reléguant dans les régions périphériques de mes réflexions ma passion pour la géologie qui m’a toujours attiré. J’ai en effet longtemps hésité à m’engager dans cette discipline. La théorie de la tectonique des plaques alliant modèles géométriques, compréhension des mécanismes de transformation des roches et références historiques à l’histoire des continents et des espèces animales m’a inspiré le modèle que j’utilise aujourd’hui pour comprendre les relations entre science et histoire.
Les divers textes présentés ici tournent autour d’une ou de plusieurs contributions ; ils ne sont pas de simples comptes rendus, ce qui, ici, n’aurait guère d’intérêt. On peut généralement y déceler deux approches complémentaires que le lecteur aura peut-être quelque peine à distinguer.
La première reprend tout ou partie des textes jugés particulièrement intéressants, ouvrages ou plus rarement articles. Cette prose relève de la part du scientifique d’une certaine facilité dans l’expression des idées. Elle succombe aux impératifs d’un type de discours souvent considéré par les éditeurs comme seul recevable par le lecteur. Elle présente donc des obscurités qui nécessitent une analyse propre à rendre la réflexion plus transparente par rapport à l’optique retenue par l’auteur. Cette remise en forme s’inspire des pratiques de l’analyse logiciste proposée par Jean-Claude Gardin sans respecter la discipline exigeante que demande ce type d’approche, ascèse qui ne ferait qu’obscurcir les composantes essentielles des discours présentés ici (Gardin 1974 ; Gallay 1989, 1998 ;). Ce type d’approche facilite ainsi la compréhension de la position des auteurs, dont je salue ici la perspicacité, sur les points jugés pertinents pour mon propos. Il relève souvent d’une certaine schématisation des savoirs qui n’est pas sans évoquer la géométrie descriptive chère à mes parents ou les schémas de Lévi Strauss et de Gardin, cela tout en restant au plus près des conceptions des auteurs que le lecteur pourra, s’il le désire, retrouver en consultant les textes originaux.
La seconde approche, complémentaire, présente les prolongements possibles de ces textes dans la perspective qui est ici la mienne et fait parfois appel à des sources supplémentaires. Elle permet de construire, par touches successives, ce qui pourrait être les bases d’une anthropologie renouvelée. Le regard que je porte à ce niveau se veut parfois critique. Il permet de sélectionner ce que je pense être essentiel et de marginaliser certaines positions qui ne correspondent pas à l’idée que je me fais des fondements théoriques de nos disciplines et de nos pratiques.
Cette double transformation aboutit donc à une réflexion qui se voudrait originale et se distancie parfois considérablement des textes qui l’ont suscitée.
Certaines réflexions ont fait l’objet d’articles dans des revues spécialisées. Je ne manquerai pas d’en rendre compte.
Aux source de l’anthropologie
En 1755, dans son « Discours sur l’origine des inégalités » Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, évoque les temps heureux de l’Antiquité où l’on pouvait entreprendre de grands voyages uniquement pour s’instruire. Il regrette que, dans un temps où l’on se pique de belles connaissances, personne ne consacre dix ans de sa vie à un célèbre voyage autour du monde, pour y étudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une fois les hommes et les mœurs, et qui, après tant de siècles employés à mesurer et considérer la maison, s’avise enfin d’en vouloir connaître les habitants pour, au retour, faire à loisir l’histoire naturelle, morale et politique de ce qu’il aurait vu. Alors nous verrions nous-mêmes sortir un monde nouveau de dessous sa plume et nous apprendrions ainsi à connaître le nôtre.
Ce texte prophétique, fondateur de l’ethnologie, précède de vingt ans le renouveau des découvertes. Rappelons quelques dates :
1768 pour Bougainville,
1769-1778 pour Cook,
1785-1788 pour La Pérouse.
Pour la première fois la découverte scientifique prime l’impérialisme territorial, la prospection des marchés économiques et la volonté d’enrichissement. Mais c’est seulement en 1796 que l’écossais Mungo Park atteint le Niger, constate qu’il coule vers l’Est, et ouvre, pour le meilleur et pour le pire, l’aire de la découvert de l’Afrique intérieure, dont seules les côtes étaient alors connues des Européens.
Egalement citoyen de Genève, comment pourrions nous ne pas évoquer le grand Philosophe des Lumières à l’occasion de nos propres voyages, tant dans les brousses sahéliennes que dans les terres plus mystérieuses encore de la pensée.
Une théorie jamais achevée
L’enrichissement d’une théorie, jamais achevée, passe par la lecture d’un certain nombre d’ouvrages sélectionnés pour leur pertinence face aux questions que nous nous posons. Plusieurs ouvrages ou articles ont particulièrement retenu notre attention ces dernières années. Nous rendons compte ici de certains ouvrages dans leur ensemble, ou de certains de leurs chapitres qui nous ont paru particulièrement pertinents pour notre réflexion.
1. Ces lectures commencent le plus souvent par une analyse logiciste de la pensée de l’auteur. Pour cela nous sélectionnons en deuxième lecture un certain nombre de citations que nous réordonnons afin de saisir au mieux les grandes articulations du discours. Ce matériau sert ensuite, dans certains cas tout au moins, à bâtir un schéma logiciste explicitant la trame des démonstrations proposées. Ces schématisations n’ont pas pour but de rendre compte de la totalité de la pensée de l’auteur, mais seulement de certaines articulations que nous jugeons particulièrement enrichissantes pour notre propre réflexion.
2. Ces lectures ne sont utiles que si elles génèrent en nous, dans leur prolongement, une réflexion propre sur laquelle il convient naturellement d’insister. Ces extensions, que nous voulons importantes, constituent la partie originale de l’exercice. Ces lectures ne sont donc pas de simples comptes rendus comme on a l’habitude d’en lire dans les revues spécialisées. D’abord parce qu’elles ne rendent pas compte des textes dans leur complétude, ensuite parce qu’elles intègrent des réflexions personnelles et « utiles » pour le développement de notre propre pensée.
3. Pour chaque thème, nous ferons en sorte de bien distinguer ce qui revient à l’auteur et ce qui découle de notre propre écriture, une position d’équité dans un exercice qui se veut un dialogue. Dialogue constructif puisque nous retenons ce qui est jugé positif, même si cette progression a pu naître d’une position critique, comme c’est le cas pour les pratiques muséales.
4. Afin d’intégrer ces réflexions dans le concret, nous avons choisi à propos de chaque thème des exemples particulièrement illustratifs des thèmes développés. Ces exemples, qui ne sont pas obligatoirement ceux présentés dans les textes originaux, sont choisis pour leur pertinence et/ou pour leur proximité avec nos propres recherches. Dans certains cas seulement évoqués, ces derniers peuvent, ou pourront, faire l’objet de développements qui n’apparaissent pas ici.
5. Le choix d’une lecture n’est jamais innocent. Menée sans plan préconçu au fil des opportunités, cette opération s’est révélée a posteriori avoir une certaine cohérence, ce qui justifie cette présente présentation. Livres découverts au hasard des librairies, ouvrages suggérés par des collègues, travaux collectifs de congrès pour lesquels nous avons collaboré aux discussions finales, catalogues d’expositions, ouvrages de fond souvent cités, mais que nos obligations universitaires ne nous avaient jusqu’alors jamais donné le temps de lire, etc. constituent une matière première hétéroclite à laquelle nous avons tenté de donner une nouvelle cohérence.

Intelligence artificielle et illusion technologique
Nos lectures sont les briques avec lesquelles nous désirons construire une compréhension intelligente et nuancée de l’histoire. Ce n’est apparemment pas l’image que les médias nous donne de l’intelligence.
A la télévision ces derniers jours un film consacré à l’intelligence artificielle (Arte 21 avril, 22h30. Ihuman : l’intelligence artificielle et nous) : terrifiant et consternant. Terrifiant : cette croyance en la toute puissance de la technologie informatique et en sa capacité à résoudre tous nos problèmes, consternant cette totale méconnaissance de l’épistémologie de la connaissance.
Les nombreuses personnes qui se font aujourd’hui les apôtres du développement de l’intelligence artificielle feraient bien de se rafraîchir la mémoire sur l’histoire des relations entre outils technologiques informatiques et développement de la connaissance.
Les réflexions proposées reposent sur notre pratique des sciences humaines et de l’archéologie, mais elles concernent des pans beaucoup plus larges de la connaissance.
Un nécessaire retour arrière
La question posée n’est pas nouvelle. Dans les années 60 les ordinateurs personnels se répandent dans les universités. Les chercheurs, enseignants et étudiants, sont fascinés par les possibilités, jugées alors illimitées, offertes par ces nouveaux instruments concernant la gestion les données. Nous avons nous-même participé à cet enthousiasme en tant qu’étudiant parisien en sciences humaines et en archéologie.
Nous admettrons tout d’abord, et en première approximation, que la sémiologie aborde les questions touchant à la représentation et à la description des données. Elle touche également aux mécanismes logiques permettant de donner une explication et une interprétation de ces mêmes données. Parallèlement le mouvement quantitatif et mathématique aborde essentiellement les questions touchant à l’acquisition des données et à la mise en ordre de ces dernières à l’aide de techniques de classification.
Cette répartition montre déjà qu’il est totalement impossible de dissocier ces deux approches qui devraient être complémentaires. Les impasses rencontrées jusqu’à ce jour découlent en partie du fait d’avoir méconnu cette complémentarité, et d’avoir prétendu fonder sa démarche sur un seul type d’approche.
Le débat théorique prend un nouveau départ dans l’après-guerre à partir des années 50.
Les divers types d’approches caractérisant l’archéologie à cette époque n’ont apparemment aucuns points communs et se développent au sein d’équipes de recherches indépendantes n’entretenant aucune collaboration scientifique entre elles. Dans tous ces cas pourtant une même philosophie d’ensemble est perceptible.
Toutes les recherches se développent en effet avec l’idée (et l’illusion) qu’il est possible de donner une description unique et exhaustive de la réalité sous la forme d’un langage documentaire unique et que, d’autre part, cette représentation de la réalité peut générer d’elle-même une interprétation, pourvu qu’on lui applique des procédures de description et d’ordination strictement contrôlées, avec ou sans l’aide de tests statistiques.
Le mouvement amorcé dans les années 50 va s’amplifier dans la décennie suivante avec la diffusion des ordinateurs dans les universités.
Le mouvement quantitatif s’amplifie et la plupart des chercheurs acquièrent la conviction que les techniques informatiques vont pouvoir résoudre tous les problèmes rencontrés.
La réflexion se concentre sur les systèmes de description des objets archéologiques et l’on poursuit l’élaboration de très nombreux codes descriptifs documentaires. La réalité, pense-t-on alors, peut faire l’objet d’une description unique et cette hypothèse permet d’envisager la création de grandes banques de données factuelles susceptibles d’alimenter une infinité d’analyses conduites par des chercheurs différents et répondant à des objectifs variés.
L’essor du mouvement quantitatif marque les années 60 avec le développement des statistiques multidimensionnelles. L’outil mathématique est appliqué au contenu des nouvelles bases de données documentaires dans l’espoir d’en tirer des théories scientifiques pertinentes. Aux États-Unis ces techniques sont rapidement incorporées dans l’arsenal hétéroclite de ce qu’on nomme alors la Nouvelle Archéologie.
Les techniques de l’analyse multidimensionnelle sont appliquées au classement des objets fondés sur des descriptions des caractéristiques intrinsèques de ces derniers. Les premières applications taxonomiques utilisent essentiellement les classifications ascendantes hiérarchiques (cluster analysis) qui construisent des représentations arborescentes qu’il suffit de couper à un niveau significatif pour obtenir une partition.
Alors que l’affinement des techniques de fouilles proposées tend à privilégier une archéologie empirique qui a de la peine à se dégager de la simple description de ses matériaux, l’essor de la Nouvelle Archéologie anglo-saxonne débouche sur l’élaboration de modèles interprétatifs ambitieux.
L’idéal explicatif transparaît clairement dans le débat qui oppose alors, aux États-Unis, les partisans d’une histoire culturelle descriptive aux archéologues qui prétendent à une compréhension interne des processus historiques. C’est à cette même époque néanmoins qu’émerge une première prise de conscience des difficultés liées à l’interprétation des vestiges.
Les années 60 apparaissent incontestablement comme une période d’enthousiasme devant les perspectives offertes par les nouvelles théories et les nouveaux outils désormais à disposition des archéologues. Trois credos théoriques semblent néanmoins alors dominer.
Le premier concerne la possibilité de donner une description exhaustive et unique de la réalité archéologique.
Le second, l’idée que cette description peut être à l’origine d’une interprétation unique de la réalité et que l’arsenal mathématique et statistique désormais à disposition est un gage du caractère scientifique de cette démarche.
Le troisième, l’hypothèse que la documentation archéologique permet d’accéder à une compréhension globale et totale de l’histoire.
D’une manière générale nous pouvons considérer qu’il s’agit de stratégies « aveugles » de recherche où la finesse de la description des données et l’application à ces dernières de procédures mathématiques sophistiquées sont considérées comme un gage d’efficacité.
Le monde anglo-saxon se déchaîne. Il est à l’origine de très nombreux articles dans lesquels la sophistication des outils mathématiques est censée déboucher sur une compréhension de l’histoire. Cette approche empirique de la réalité, qui ne débouche en fait que sur des interprétations d’une très grande pauvreté, est contrebalancée par l’introduction de modèles hypothético-déductifs ambitieux dont les liens avec les données empiriques sont loin d’être éclaircis.
Les années 70 vont pourtant voir surgir toute une série de difficultés et d’impasses méthodologiques. Le mouvement d’enthousiasme s’essouffle et l’on commence à prendre conscience des limites des approches proposées.
Au niveau de la fouille les techniques très sophistiquées de dégagement des vestiges prônées par André Leroi-Gourhan semblent également déboucher sur certaines impasses. Le volume des informations à digérer est souvent si volumineux qu’il devient impossible de les traiter dans un temps raisonnable. La précision de la fouille devient un obstacle au recul nécessaire permettant la compréhension des vestiges.
Les stratégies de description « exhaustive » se développent de façon spectaculaire, le travail d’enregistrement étant facilité par l’affinement des techniques informatiques. De nombreux projets de banques de données voient le jour.
Le préhistorien Henri de Lumley propose notamment la création d’une banque de données universelle de toutes les informations recueillies au niveau mondial lors des fouilles. Ce projet délirant ne verra jamais le jour. Ces divers échecs semblent alors liés à la confusion existant entre cibles documentaires (retrouver des données pertinentes) et cibles scientifiques (faire surgir du sens).
La fin des années 60 et le début des années 70 marquent le maximum d’engouement pour les procédures mathématiques d’ordination. L’école française d’analyse de données de Jean-Paul Benzécri est alors à la mode, et nombreux sont, en sciences humaines, les auteurs qui s’y réfèrent. Les classements restent pourtant décevants du point de vue interprétatif. C’est pour parer à cette situation que l’on propose alors des méthodes d’analyse encore plus sophistiquées, telles que l’analyse de correspondances.
D’une façon générale ces techniques permettent de bien mettre en évidence la structure d’ensemble des données mobilisées, mais restent d’une extrême pauvreté sur le plan interprétatif. Cette situation sanctionne l’échec des stratégies aveugles qui n’offrent pas de solution au guidage de la description des données.
Parallèlement, le mouvement logiciste initié par l’archéologue Jean-Claude Gardin s’attache à mieux comprendre les fondements des raisonnements qui permettent de passer de la description des données aux interprétations.
On constate alors les limites des stratégies où l’on postule que le formalisme de la représentation ou du traitement des données conduit automatiquement à des découvertes sur le plan empirique et les inconséquences tactiques des recherches où l’on aborde séparément représentation, traitement et interprétation des données. Une réflexion en profondeur porte désormais sur les procédures permettant d’attribuer du sens aux données.
Pour la première fois l’on prend conscience de l’importance des références extérieures,
indépendantes des données traitées, dans le processus d’interprétation.
Les années 70 marquent essentiellement l’échec des stratégies aveugles de description et d’ordination des faits. Le mouvement sémiologique amorce pourtant dès cette époque la réflexion qui permettra de sortir de l’impasse en insistant sur l’importance jouée par les connaissances du moment dans le guidage de la description des données et dans l’interprétation de ces dernières, marquant ainsi la fin des stratégies aveugles de recherche et la primauté de la raison sur la technicité.
Après les espoirs déçus des années 70, les années 80 sanctionnent le retour à une démarche plus pragmatique, peut-être moins ambitieuse, et à une meilleure intégration des mathématiques dans le raisonnement.
Il aura fallu vingt ans pour que l’on se rende compte de nos erreurs, erreurs reprises aujourd’hui par ce que l’on nomme abusivement l’intelligence artificielle.
On admet désormais une infinité de descriptions possibles d’un même objet et les critères retenus ne peuvent découler que de l’intuition, des connaissances préalables et des objectifs poursuivis par le chercheur. En l’état actuel de notre art, les grandes banques de données scientifiques n’ont pas de sens.
Il convient donc de limiter ces grandes entreprises collectives aux aspects strictement documentaires (recherche des données jugées utiles). Les banques de données scientifiques doivent rester des entreprises locales et éphémères, orientées vers des problématiques « individuelles ».
Le développement des ordinateurs permet du reste désormais le développement de ce type plus souple de stratégie. En deux mots la guérilla, et non la guerre, est jugée optimale pour résoudre nos problèmes de description.
On assiste désormais à une meilleure intégration du quantitatif dans une démarche archéologique plus clairement définie :
– Une réflexion préliminaire sur la signification potentielle des caractéristiques (essentiellement intrinsèques) des objets est jugée indispensable.
– La sophistication et la rapidité de calcul croissante des ordinateurs permettent désormais de proposer des méthodes itératives de guidage des descriptions et des procédures d’ordination permettant de faire apparaître des structures stables.
Ces expériences ponctuelles s’écartent résolument des ambitions unificatrices des recherches en intelligence artificielle des années 60 pour s’intéresser aux raisonnements propres à chaque recherche, dans les domaines les plus divers. Elles mettent en évidence les pratiques éminemment discursives des archéologues et le caractère « local » des démonstrations. Elles montrent par contre que le cumul des connaissances propres à plusieurs chercheurs permet d’enrichir considérablement l’approche des thèmes particuliers à chaque domaine de recherche.
Le formalisme logiciste se prête bien à la mise en oeuvre de systèmes experts de ce genre comme on le propose actuellement en médecine; il peut rendre compte de l’architecture des raisonnements sous forme de réseaux, mais ne donne pas de réponse directe aux fondements des relations dérivations entre propositions, qu’il invite seulement à expliciter. Le système expert ne travaille que sur les données introduites dans le système et ignore toutes données dissidentes. On ne peut que constater ici le blocage de la progression des connaissances dépendantes des donnée introduites dans le système.
L’un des apports essentiels de la recherche des années 80 est sans conteste la reconnaissance du caractère local des problématiques. A tous les niveaux de son analyse, choix du corpus, définition des critères de description, mise en oeuvre des techniques d’ordination, mathématiques ou non, et interprétation, l’archéologue doit tenir compte de cette situation.
Malgré la puissance de plus en plus grande des outils mathématiques développés, la recherche butte contre deux types de difficultés :
– La première concerne l’insuffisance des données archéologiques, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Les faits mobilisés ne sont souvent pas à la hauteur des méthodes utilisées.
– La seconde découle des limites rencontrées dans les tentatives de description exhaustive de la réalité. On se rend compte en effet aujourd’hui que l’augmentation du nombre des descripteurs n’est pas une réponse à l’absence de réflexion portant sur la recherche des critères pertinents. Les premiers systèmes descriptifs mélangeaient allègrement des caractéristiques dont les fondements étaient hétérogènes. Les structures d’ordre dégagées sur cette base ne pouvaient avoir de signification sur le plan historique et/ou anthropologique.
Les échecs enregistrés dans le domaine de l’interprétation des structures d’ordre dégagées montrent qu’il est indispensable de guider le processus de description et d’ordination à partir d’hypothèses fortes de caractère forcément intuitif. Cette situation montre que le courant mathématique ne peut survivre que subordonné au courant logiciste.
Ce dernier pourrait comprendre trois niveaux emboîtés :
– Le premier niveau pourrait être la recherche, dans un cadre actualiste, d’une meilleure adéquation entre fait matériel et interprétation à travers l’archéologie expérimentale et l’ethnoarchéologie. Toutes les sciences d’observation intégrant une perspective historique (astronomie, géologie, paléontologie) se situent dans cette perspective.
– Le second niveau pourrait intégrer, sur le plan formel, les acquis du logicisme en mettant en avant la nécessaire interaction existant entre hypothèses interprétatives et description. Les schématisations logicistes permettront probablement à l’avenir de sortir de l’impasse provoquée par l’inflation actuelle d’une littérature surabondante, dont les chercheurs ne peuvent plus, matériellement et intellectuellement, assimiler le contenu.
– Enfin, il n’existe aucune raison de rejeter les acquis obtenus dans le développement des méthodes mathématiques si on les situe, à la place qui leur revient, dans les procédures d’ordination des données.
Ainsi le long chemin parcouru depuis les années 50 débouche-t-il sur une constatation banale. L’archéologie pourra trouver une issue à ses problèmes dans la mesure où elle se conformera au schéma unitaire de toute recherche scientifique, car le schéma auquel nous aboutissons possède, croyons-nous, une validité qui dépasse clairement le cadre strict de notre discipline pour s’appliquer à n’importe quel domaine de la réalité. L’intelligence artificielle actuelle ignore ces contraintes.
L’intelligence artificielle aujourd’hui
Aujourd’hui l’intelligence artificielle reproduit en grand les mêmes errements que dans les années 60 dans un contexte de sacralisation des moyens techniques.
L’idée est qu’une description exhaustive de la réalité peut déboucher sur du sens indépendamment d’une problématique.
Mais il existe un écueil beaucoup plus pernicieux.
Les données dont se nourrissent les systèmes sont issues majoritairement des réseaux sociaux, dont on peut douter qu’elles illustrent une réflexion approfondie sur les réalités de notre monde, même si elles peuvent véhiculer parfois des réflexions intéressantes. Le bavardage envahissant dont se nourrissent les machines constitue un corpus d’une désolante pauvreté. Comment cela peut-il constituer le fondement d’une compréhension de notre monde ?
La démarche se trouve à l’opposé d’une réflexion approfondie et ne mérite aucunement l’étiquette d’intelligence. Il s’agit seulement d’une compilation permettant de manipuler et d’asservir les humains, dans un processus monstrueux et concentrationnaire basé sur une totale méconnaissance de ce qu’est la connaissance. Le système chinois donne un magnifique exemple de ce que donne cette intelligence artificielle dévoyée construite pour le contrôle des populations et le développement d’une pensée unique ne donnant aucune place à la contestation et à l’inventivité.
Elle fait l’impasse sur les grands défis de notre monde en cours d’effondrement, laissant de côté les vrais problèmes comme la relation entre le capitalisme sauvage, la logique extractive des énergies fossiles et les désastres planétaires. Toute ces questions soulevées notamment par Naomi Klein, aurait pu fonctionner comme des questions pouvant guider la collecte de données pertinentes et leur intégration dans une structure signifiante. Elles n’ont généré que des entreprises limitées et déconnectées les unes des autres, alors que nous possédons désormais les moyens de mieux comprendre notre monde dans sa globalité et ses dynamiques.
Les erreurs des années 60 ne concernaient que la compréhension de l’histoire, peut être un moindre mal. L’intelligence artificielle actuelle est cent fois plus pernicieuse car il s’agit d’un instrument d’asservissement des humains fondé sur une totale mécompréhension des voies de la connaissance et sur la récolte de données hautement suspectes. Nous ne voyons dans ce processus rien qui mérite le nom d’intelligence.
Reste le dossier de la robotique que nous ne saurions traiter ici en détail. Deux remarques suffiront ici.
La première concerne l’empreinte carbone que la construction de ces gadgets, le plus souvent inutiles, génère et dont personne ne semble ici se soucier.
La seconde concerne la question de savoir si nous sommes en présence d’une forme d’intelligence. Pour nous l’intelligence est contestation des savoirs et recherche d’une meilleure compréhension de notre univers. Les monstruosités techniques construites par nos techniciens, qui voudraient concevoir des machines imitant des comportements humains et, à terme, nous remplacer, ne relèvent pas de l’intelligence, tout au plus d’un savoir technique dévoyé dont l’objectif n’est pas la connaissance. La technique devrait répondre à des objectifs explicites. Ici pas d’objectifs affichés. Le robot ne remplacera jamais la souplesse et la richesse de la réflexion humaine.
On rejoint ici Edgar Morin. Les machines artificielles ont, en même temps, développé leurs compétences organisationnelles, et nécessairement leur autonomie. Toutefois, si développée soit-elle, la machine artificielle semble par rapport aux machines vivantes, à la fois une grossière ébauche et une pâle et ridicule copie. La plus perfectionnée et la plus avancée des machines artificielles est incapable de se régénérer, de se réparer, de se reproduire, de s’organiser, qualités élémentaires dont dispose la moindre des bactéries. Elles n’ont pu développer de la générativité organisationnelle, quoi qu’en disent les apôtres de la robotique. Tout en reflétant, exprimant et prolongeant la créativité sociale, les machines artificielles, dans leur pauvreté et rigidité organisationnelle sont le reflet des sociétés qui les ont produites.
J’ai regroupé mes réflexions au sein de onze chapitres qui couvrent, je l’espère, les principaux enjeux de l’anthropologie actuelle. Ils témoignent des multiples ponts qui se construisent entre les chercheurs et permettent d’éliminer toute prétention personnelle dans une construction égoïste des savoirs.
La personnalisation des diverses parties témoigne de la grande diversité des perspectives.
Le savant
Peut-on trouver une unité pour la connaissance ? Une question se pose tout en amont de notre quête : est-il possible de trouver une unité pour la connaissance qui pourrait englober aussi bien les sciences humaines que les sciences dites dures. Peu de chercheurs se sont aventurés sérieusement sur cette voie. On peut néanmoins démontrer que cette unité peut s’identifier pour peu que l’on rendre leur autonomie aux divers points de vue que l’on peut porter sur un même objet. Ce pari est au fondement de notre démarche.
Alain Testart (1991)est aux fondements de cette réflexion qui doit également intégrer la position de Jean Claude Passeron (1991)dont le livre propose une image inversée. Carl Hempel (2004)nous aide à comprendre comment se forment les concepts et l’approche de Jerry A. Fodor (1986, 2003)explore la possibilité d’identifier au niveau neurologique les supports de ces mécanismes, ce qui interroge les fondements même du logicisme. Enfin le roman le Jeu des perles de verred’Herman Hesse (1955)cher à Jean-Claude Gardin, révèle les difficultés rencontrées dans la construction d’un savoir organisé de ce type à l’opposé des « pages de variétés » qui caractérisent trop souvent le discours des sciences humaines, mais propose une vision pessimiste de cette exigence qui ne pourrait être le propre que d’une petite élite de penseurs qui ne trouvera jamais la reconnaissance sociale.
- Testart A. 1991. Pour les sciences sociales : essai d’épistémologie.
- Passeron J.-C. 1991. Le raisonnement sociologique : l’espace non poppérien du raisonnement naturel.
- Hempel C. 2004. Éléments d’épistémologie.
- Fodor J. 1986. La modularité de l’esprit : essai sur la psychologie des facultéset2003.L’esprit, ça ne marche pas comme ça.
- Hesse H. 1955. Le jeu des perles de verre.
Comment concilier notre pratique scientifique et les grands défis posés actuellement par la crise écologique ? Deux livres nous aident à réfléchir à cette question.
« L’idée de nature a pu servir un temps à exprimer toutes sortes d’aspirations confuses et de projets informulés, et c’est la raison pour laquelle l’écologie a d’abord été pensée comme le projet de sauver la nature, ou de la conserver – un projet consistant simplement à accorder de la valeur à ce qui autrefois n’en avait pas. Mais en dépit de cette utilité tactique que je reconnais à l’idée de nature, il me semble nécessaire de répéter que cette notion a fait son temps et qu’il faut maintenant penser sans elle. » (Descola 2017)
- Bonneuil, C., Fressoz, J.-B. 2016. L’évènement anthropocène : la terre, l’histoire et nous.
- Descola P. 2005. Par-delà nature et culture.
Le scientifique et le littéraire
Faut-il opposer science et littérature ? Les sciences humaines se situent volontiers dans une « troisième voie » qui serait ni science, ni littérature. On peut démontrer qu’il est possible d’éviter cette confusion, qui est également une voie de facilité, en recherchant les fondements d’un vrai discours scientifique.
Deux contributions permettent d’approfondir le livre essentiel de Wolf LepeniesLes trois cultures : entre science et littérature, l’avènement de la sociologie(1997)qui explore les résistances opposées à la vision considérée comme « scientiste » de Durkheim. Vincent Debaene (2010)analyse le rôle ambigu des productions françaises touchant aux sciences sociales depuis l’époque de la fondation du Musée du Trocadéro jusqu’à aujourd’hui. Les livres de Dominique Sewane (2003, 2004)sur les rites de la mort chez les Batamariba du Togo et du Bénin fournissent un excellent exemple de cette position ambiguë que l’on trouve dans la collection de récits Terres humainestout en proposant une information inestimable sur les rites funéraires. Ces deux ouvrages suscitent de ma part dans leur prolongement une critique de la position de Clifford Geertz (1986)sur l’ambigüité du discours des acteurs comme compréhension ultime des phénomènes sociaux.
- Debaene V. 2010. L’adieu au voyage
- Sewane D. 2003. Le souffle du mort : la tragédie de la mort chez le Batãmmariba du Togo et du Bénin
L’informateur
Comment mobiliser le discours des acteurs ? Les ethnologues se reposent volontiers sur les discours de leurs informateurs pour identifier la signification des faits culturels auxquels ils se trouvent confrontés. Mais on peut se demander si nos informateurs doivent toujours avoir le dernier mot et s’ils possèdent la clé ultime de la signification des comportements qui les caractérisent ?
Les trois contributions que je retiens ici permettent d’enrichir la question du discours des acteurs évoquée dans le chapitre précédent. Il est toujours tentant de recourir à l’ethnographie pour interpréter certaines découvertes de l’archéologie. L’ethnologie des Sereer à laquelle a recours Margerite Dupire (1977, 1985)permet ainsi d’éclairer la découverte d’un chien associé à une sépulture sous tumulus du site mégalithique de Santhiou Kohel au Sénégal. Cette confrontation permet d’étudier les relations entre le dire et le faire susceptible de laisser des traces au niveau archéologique. Le livre collectif édité par Luc Pequet (2018)en l’honneur Jean Rouch permet de comprendre la vision dualiste du cinéaste qui oppose constamment stratégie classique de collecte systématique des faits et potentialité de prise en charge de l’imaginaire des acteurs. Enfin Alain Testart (1986, 2014)explore les causes de la division sexuelle du travail et aboutit à une règle universelle de la pensée justifiant cette opposition, ce qui met en lumière selon moi l’opposition possible entre conscience vigile (discours des acteurs et discours scientifique) et conscience autistique (distinction entre forme et sens) autre terme pour désigner l’inconscient collectif.
- Dupire M. 1977. Funérailles et relations entre lignages dans une société bilinéairw : les sereer (Sénégal) et 1985. Les tombes de chien : mythologie de la mort en Pays sereer (Sénégal)
- Pequet L. (éd) 2018. Jean Rouch ethnologue et cinéaste.
- Testart 1986 et 2014. Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs et 2014. L’amazone et la cuisinière
L’ethnographe
L’ethnographie a-t-elle encore un avenir ? Selon certains la disparition ou l’acculturation des population traditionnelles et la mondialisation pourraient signer la fin de l’ethnographie. La constitution d’une anthropologie générale repose ainsi de plus en plus sur une ethnohistoire dont il s’agit de définir les règles.
A propos de l’étude comparative des pratiques cannibales,George Guille-Escuret (2012)dresse la liste des diverses sources historiques susceptibles d’être mobilisées dans l’étude de ce phénomène. Dans une analyse historique extrêmement documentée Serge Tcherkezoff (2010)déconstruit les mythes élaborés lors des premiers contacts par les Européens à propos de la pseudo-liberté sexuelle des Tahitiennes et analyse les méprises résultant d’une double mécompréhension des comportements des Européens par les habitants des îles et de ceux des Tahitiens par les premiers navigateurs, une mécompréhension dont on ne peut que constater les ravages engendrés dans l’imaginaire occidental et les préjugés qui auront la vie dure jusqu’à aujourd’hui.
Jean Boulegue (2013)propose une étude historique des royaumes wolof de Sénégambie du XIIIeau XVIIIes. qui peut être mobilisées comme cadre historique pour comprendre le développement des sépultures tumulaires de l’aire mégalithique.
Enfin Nastassja Martin (2016) explore le devenir des peuples de chasseurs-cueilleurs de l’Alaska et montre le caractère ambigu de la notion de conservation de la nature qui court circuite les intérêts des populations autochtones.
- Guille-Escuret G. 2012. Les mangeurs d’autres ; civilisation et cannibalisme.
- Tcherkezoff S. 2010. Tahiti 1768 : jeunes filles en pleurs, la face cachée des premiers contacts et la naissance du mythe occident.
- Boulègue J. 2013. Les royaumes wolof dans l’espace sénégambien (XIIIe-XVIIIe siècles).
- Martin N. 2016. Les âmes sauvages : face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska.
L’anthropologue et le lexicographe
Comment s’astreindre à bien penser ? L’anthropologie a besoin d’une réflexion approfondie de façon à mieux définir les concepts qu’elle utilise que ce soit au niveau économique qu’au niveau sociologique ou politique.
Les travaux abordant de front cette question sont rares mais plusieurs livres permettent de me situer par rapport à cette exigence dont Alain Testart (2004-2010)c’est fait le promoteur. Ils se situent dans la perspective d’une analyse des différents types de sociétés.
Ce livre édité par Christian Jeunesse, Pierre le Roux et Bruno Boulestin (2016)aborde la question de la définition du mégalithisme et des relations entre ce type de monuments et les sociétés qui en sont à l’origine. Elle peut se prolonger au niveau des discussions m’opposant à Alain Testart à ce propos (Gallay 2015). La monographie d’Augustin Holl (2014) n’offre pas le meilleur exemple de publication de fouilles archéologiques, loin s’en faut. Elle permet néanmoins de questionner la question de la hiérarchisation des sociétés africaines chère à l’archéologie anglo-saxonne. Il est possible de proposer dans son prolongement une critique de la notion d’hétérarchie proposée par McIntosh (2005)et de construire un modèle opposant mécanismes techno-économiques pouvant répondre au modèle hétérarchique et mécanismes socio-économiques correspondant à un modèle hiérarchique. Claude Sterckx (2005) et Philippe Descola (1993)évoquent les difficultés d’analyse du concept de chasse aux têtes. Le comparatisme ethnographique implique que l’on se place entre les généralisations abusives et les analyses approfondies de cas particuliers. Seule l’analyse structurale des systèmes de relations sociales permet d’approcher cette question. La grosse monographie de Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera et al(2012)sur la diffusion des haches de jade d’origine alpines permet d’initier une réflexion sur certains concepts anthropologiques utilisés par les archéologues issus notamment de l’expérience de l’ethnologie de l’Irian Jaya en Nouvelle Guinée : échanges marchands, bien de prestige, société carnacéenne royale, chefferies, sociétés ploutocratiques ostentatoires, échanges compétitifs.
- Jeunesse C., le Roux P., Boulestin B. (éds) 2016. Mégalithismes vivants et passés : approches croisées.
- Holl A. 2014. Archaeology of Mound-Cluster in West Africa.
- Sterckx C. 2005. Les mutilations des ennemis chez les Celtes préchrétiens.
- Pétrequin, Cassen S., Errera M, et al(éds) 2012. Jade : grandes haches alpines du Néolithique européen, Veet IVemillénaires av. J.-C.
L’archéologue
Comment mobiliser les données archéologiques ? Leroi-Gourhan a défini le cadre exigeant pour la mobilisation des vestiges archéologiques mais il est resté très en retrait des modalités de leur interprétation. Ce domaine requiert à la fois des apports des sciences de la nature, de l’ethnographie et de l’expérimentation.
Plusieurs travaux donnent à réfléchir sur cette question. A propos du campement magdalénien de Pincevent Michèle Julien et Claudine Karlin (2014), tr ès engagées dans ces fouilles, approfondissent la notion d’exhaustivité des observations et identifient les trois voies de la compréhension des structures préhistoriques, soit, dans le domaine des sciences de la nature, la biologie, l’éthologie du renne, dans le domaine de l’anthropologie, l’ethnologie des peuples arctiques ainsi qu’au niveau expérimental les processus de taille du silex.
L’étude des cimetières mésolithiques de Téviec et Hoedic de Bruno Boulestin (2016)répond à une réévaluation taphonomique exigeantes de ces sépultures. Elle est également l’occasion d’une analyse théorique et critique de plusieurs notions utilisées dans l’analyse des sépultures et d’une critique radicale des positions de la Nouvelle Archéologie dans laquelle on constate une confusion entre complexité d’un rite et complexité d’une société. Divers critères d’identification sociale et les relations entre richesse et types de société sont également analysés.
La monographie éditée parBrigitte Gratien (2013)est consacrée à la prospection d’une zone mal connue du Kordofan occidental au Soudan. Elle pose la question de l’enrichissement des observations ponctuelles d’une prospection dans une perspective historique générale.
- Julien M., Karlin C. (éds). 2014. Un automne à Pincevent : le campement magdalénien du niveau IV20.
- Boulestin B. 2016. Les sépultures mésolithiques de Téviec et Hoedic : revisions bioarchéologiques.
- Gratien, B. (éd). 2013. Abou Sofyan et Zankor :prospection dans le Kordofanoccidental (Soudan).
Le linguiste
L’étude des langues est-elle utile à l’histoire ? L’étude des langues et des relations qu’elles entretiennent entre elles permet-t-elle d’approfondir les scénarios de l’histoire. ? Ce type d’approche a été à l’origine de nombreux déboires notamment dans le cadre de l’histoire des Indo-Européens. Le morcellement linguistique africain, notamment dans la zone sahélienne permet pourtant une mobilisation utile de ce type d’information.
Roger Blench (2006),qui a travaillé avec nous en Pays dogon au Mali dans le cadre du programme de recherches dirigé par Eric Huysecom, est un partisan de l’utilisation de la linguistique dans l’établissement des scénarios historiques. Il étudie les conditions de passage d’une classification des langues – phénétique (proximités globales) ou cladistiques (processus de descendance avec modification) à une classification phylogénétique (interprétation en termes historiques) ainsi que la pertinence des racines linguistiques des protolangages pour définir un certain nombre d’innovations techniques et/ou économiques. Les livres de Jean Chapelle (1982) et Catherine Baroin (1972, 2003)consacrés aux Toubou du Sahara central permettent de tester la possibilité d’utiliser des données ethnologiques subactuelles pour les appliquer à la compréhension des faits archéologiques du Passé. Le point le plus intéressant concerne le marquage du bétail comme expression d’une société pastorale acéphale. Certaines données de ces livre essentiellement ethnologiques trouvent des prolongements au niveau de l’étude des représentations rupestres en termes de structures sociales et politique et en termes d’appartenance linguistique.
- Blench R. 2006. Archeology, language and the African past
- Baroin C. 2003. Les Toubou du Sahara central.
Le classificateur et le structuraliste
Comment identifier la dynamique des phénomènes ? Il y a plusieurs façons de classer les phénomènes culturels. Si certaines approches permettent seulement de décrire des proximités entre phénomènes d’autres approches qui intègrent la notion de descendance avec modification permettent de décrire des dynamiques de transformation des sociétés pouvant éclairer les transformations historiques des cultures.
Dans son livre Avant l’histoireAlain Testart (2012)qui combine archéologie et ethnographie propose une structure évolutive rendant compte des transformations des sociétés. Il oppose à cette occasion la notion, théorique, de société à celle, concrète, de culture. Ce travail est l’occasion de présenter les divers types de classifications permettant d’ordonner les phénomènes culturels. Pascal Tassydans L’arbre à remonter le tempset Pierre Darlu et Pascal Tassy (1993)dans La recontruction phylogénétique du vivant donnent les bases de la méthode cladistique dont je fais usage. Ces livrent présentent une vision essentiellement paléontologique. On trouvera par contre dans le livre de Michael O’Brien, R. Lee Lyman (2003) Cladistics and archaeologyune perspective plus archéologique de ce type de problématique. De l’énorme somme historique des Stephen J. Gould (2006)sur La structure de la théorie de l’évolutionil est possible de proposer une vue alternative des mécanismes structuraux de l’évolution en distinguant un sommet structural (Gould), un sommet historique (Hennig) et un sommet fonctionnel (Darwinisme classique). Ce modèle des trois sommets permet de préciser les notions de contingence, de parallélisme et de convergence en histoire.
Enfin l’analyse des livres de D’Arcy Thomson (1994) Forme et croissance et D’André Leroi-Gourhan La mécanique vivante (1983) est l’occasion d’aborder deux étude consacrées aux formes du squelette qui évoquent le structuralisme et de souligner l’influence de D’Arcy Thomson sur Claude L’évi Strauss.
- Tassy, P. 1991. L’arbre à remonter le temps : les rencontres de la systématique et de l’évolution.
- Testart A. 2012. Avant l’histoire : l’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac.
- Gould S. J. 2006. La structure de la théorie de l‘évolution.
- D’Arcy Thomson 1994. Forme et croissance et Leroi-Gourhan Mécanique vivante (1983).
L’évolutionniste
L’évolution des sociétés présente-elle certaines régularités ? L’évolutionnisme, notamment dans le domaine culturel, n’est guère à la mode et l’on a mis en doute le fait que les cultures puissent évoluer selon des schémas unitaires. Le discrédit sur ce mode de compréhension de l’histoire vient notamment du fait que les propositions se situant dans cette perspective restaient d’une simplicité largement caricaturale. Une approche plus approfondie pouvant tenir compte de divergences propres à certaines régions est pourtant possible.
Éric Boeda (2013)analyse la question des transformations historiques des industries lithiques en apposant les notions de technologie (correspondant à nos scénarios) et de techno-logique (correspondant à des régularités structurales). Il critique à cette occasion la notion de tendance de Leroi-Gourhan en insistant sur le fractionnement des lignées évolutives techniques. Le livre d’Abdulaye Bara Diop (1981) consacré aux transformations de la société wolof du Sénégal peut être lu à travers une analyse cladistique reposant essentiellement sur des transformation internes à la société alors que les facteurs historiques externes comme le développement de l’esclavage peut se comprendre comme des facteurs externes permettant d’expliquer certaines transformations. A travers le livre de William Y. Adams (1977)sur la Nubie il est possible de proposer une structuration cladistique des sociétés de la vallée du Nil visible à travers les transformations de leurs rites funéraires. On peut distinguer à cette occasion une évolution interne transformée par l’influence de la civilisation étatique égyptienne. L’ouvrage de Georges Guille-Escuret (2010)sur la sociologie comparée du cannibalisme présente un double intérêt. Il fournit d’abord matière à réflexion à propos du cannibalisme identifié par Bruno Boulestin et Anne-sophie Coupey (2015)sur le site néolithique rubané d’Erxheim dans le Palatinat. Dans le domaine africain, la perspective développée permet de poser un regard critique les positions adoptées par la Société d’anthropologie de Paris sur le sujet. Il permet de proposer un modèle illustrant la liaison entre cannibalisme et horticultures forestières à l’écart des civilisations étatiques. Le cas d’Exheim montre pourtant les limites d’une telle généralisation.
- Boëda E. 2013. Techno-logiques et technologie : une paléohistoire des objets tranchants.
- Diop A. B. 1991 La société wolof, tradition et changement : les systèmes d’inégalité et de domination.
- Guille-Escuret G. 2010. Sociologie comparée du cannibalisme : 1. Proies et captifs en Afrique.
- Hamany D. 2006. Le sultanat touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie.
- Adams W. Y. 1977. Nubia : corridor to Africa : Corridor to Africa
L’historien
Une vie pour retrouver l’unité de l’histoire ? De très nombreux chercheurs critiquent largement les positions que je défends à propos des relations entre anthropologie et archéologie reprenant des critiques connues depuis longtemps comme on peut le voir dans Paul Courbin (1988) à propos de mon livre L’archéologie demain(Gallay 1986, 2018).
Dans son livre Qu’est-ce que la préhistoire Sophie de Beaune (2016)consacre ainsi quelques pages à une critique de mes positions épistémologiques. Cette réflexion qui, passe à côté des vraies questions, est pour moi l’occasion de préciser les composantes de ma démarche historique, démarche testée à l’occasion de l’étude des rite funéraires préislamiques sahariens et sahéliens.
- De Beaune, S. 2016. Qu’est-ce que la préhistoire.
Le muséographe
Des musées d’ethnographie pour quoi faire ? l’institution muséales héritée des préjugés de la colonisation est aujourd’hui en profonde crise. La situation est d’autant plus grave qu’il existe des liens troubles entre ce type d’institution et le marché de l’art et que les populations spoliées par la colonisation demandent aujourd’hui la restitution de nombreux objets, vidant ainsi les musées occidentaux de leur contenu. La situation est aujourd’hui d’autant plus dramatique que les réponses apportées à cette situation ne nous paraissent guère adéquates.
Le livre de Mauren Murphy (2009)propose une mise en perspective historique de la présentation des arts extra-occidentaux dans les musées et dans l’imaginaire occidental, un voyage de l’Afrique marchandise à l’Afrique rêvées de la négritude. On peut se demander s’il n’y a pas ici escamotage de la vision anthropologique qui permettrait de remettre en question de la notion d’art. Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel jouissait jadis d’une grande renommée internationale grâce à la collaboration de jean Gabus qui avait travaillé chez les Inuit et en Afrique, au Sahel et le peintre renommé Hans Erni. Le livre de Jean Gabus et Hans Erni (1954)illustre la collaboration qui peut se nouer entre un artiste hors du commun et un ethnologue dont il faut saluer le profond respect pour les populations rencontrées dans un musée instrument de connaissance. Une collaboration qui me touche au plus haut point en tant que fils de peintre. Cet héritage a été remis en question par plusieurs expositions et les contributions de Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaerth (2002)qui, à travers un historique des visions multiples de l’Occident sur les objets exotiques en viennent à constater la faillite des musées d’ethnographies en avançant l’idée d’un objet cannibalisé sans proposer de véritables alternatives à travers la promotion d’un musée postmoderne. Le catalogue de l’exposition Dogon du Musée du quai Branly, édité par Hélène Leloup (2011),est la triste expression d’objets « œuvres d’art », par ailleurs totalement récupérés par l’économie libérale occidentale. Il est pourtant possible de proposer une autre lecture de ces objets ici sortis de tout contexte. Le Musée d’ethnographie de Genève, dont Jacques Hainard avait assuré un temps la direction par interim suite à la retraite de Louis Necker, tente aujourd’hui de renouveler le genre. Le catalogue L’effet boomerangconsacré aux populations indigènes australiennes et édité par Roberta Colombo-Dougoud (2017)ne parvient néanmoins pas à se dégager de l’emprise des dérives du marché de l’art. La réflexion anthropologique est ici encore une fois marginalisée. Pour moi la seule porte de sortie serait de se consacrer à l’étude des cultures aborigènes au moment des premiers contacts et de développer des relations avec la recherche fondamentale, une preuve de respect absolument nécessaire. Je reste néanmoins aujourd’hui pessimiste et ne sait guère quelles voies préconiser pour sortir de l’impasse.
- Murphy M. 2009. De l’imaginaire au musée : les arts d’Afrique à Paris et à New York (1931-2006).
- Gabus J, & dessins d’Hans Erni 1954. Initiation au désert.
- Leloup H. 2011. Dogon.
- Colombo Dogoud R. (éd.) 2107. L’effet boomerang : les arts insulaires d’Australie.
Conclusion
Il convient désormais de tirer quelques leçons de ces lectures. Quatre grands axes se dégagent.
- Le premier concerne la nécessité de dégager nos pratiques des libertés qui constituent les fondements mêmes de la littérature pour créer une épistémologie comparable à celle des sciences de la nature. Que l’on soit clair sur cette démarche. Nous sommes aujourd’hui loin de compte et nous n’avons aucunement la prétention de proposer des recettes permettant d’atteindre immédiatement ce but. Il ne s’agit que d’une quête sur le long terme. D’aucuns ont considéré cette prétention comme exorbitante, elle ne l’est que si nous disons avoir atteint notre but. Ce n’est, de loin, pas le cas.
- L’autre acquis concerne l’institution muséale. Les diverses expériences menées dans ce domaine sont loin d’être concluantes face au respect que nous devons aux cultures autres et la reconnaissance de ce qu’elles nous ont apporté, ceci sans angélisme. Toutes les cultures présentent leur part d’ombre.
- La solution de la question posée par le point 2 ne peut être résolue qu’en adoptant le point 1. Reconnaître que les sciences humaines peuvent relever d’une approche scientifique, c’est à dire universelle, n’est aucunement nier les spécificités culturelles, mais développer un langage permettant de respecter ces dernières. Il n’y a aucun impérialisme occidental là dedans, sinon celui de la connaissance. Cela a aujourd’hui une certaine actualité, au moment où un capital destructeur s’est emparé de la planète et où les idéologies totalitaires que certaines religions lui opposent dans la violence sont issues d’un obscurantisme moyenâgeux.
- Reste le domaine de la littérature et de l’art qui constitue un champ à part pouvant accueillir toutes les libertés et tous les excès, ce qui est aussi le propre de l’homme.
Ci-dessous une conclusion plus étoffée résumant mes engagements
NE MANQUEZ PAS LA DERNIERE PAGE LECTURE CONSACREE A VERMEER POUR DECOUVRIR COMMENT MOBILISER LES OBJETS REPRESENTES DANS LES TABLEAUX POUR COMPRENDRE LES RESSORTS DE L’HISTOIRE.
Professeur Alain Gallay
Site réalisé par Lune d’Elle
Menu principal
Contactez Alain Gallay